- Accueil ›
- Thérapeutique ›
- Médicaments ›
- Recherche et innovation ›
- Maladie de Parkinson, vers un avenir post-dopamine
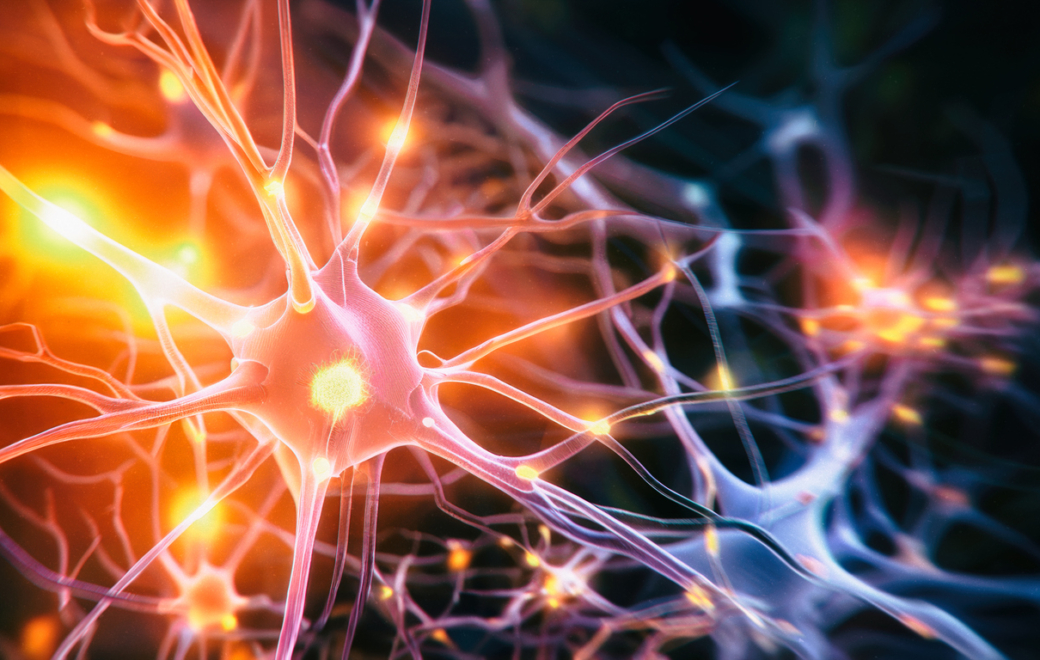
© Getty Images
Maladie de Parkinson, vers un avenir post-dopamine
Près de 60 ans après sa première utilisation en pratique clinique, la lévodopa (ou L-dopa, un précurseur du neurotransmetteur dopamine) demeure le traitement de référence de la maladie de Parkinson. Depuis, d’autres médicaments l’ont rejointe, en particulier des agonistes dopaminergiques et des inhibiteurs d’enzymes agissant sur le métabolisme de la dopamine, tels que les inhibiteurs de la monoamine-oxydase B (MAO-B) et les inhibiteurs de la catéchol-O-méthyltransférase (COMT).
De manière similaire à la diabétologie, certaines de ces spécialités, dont la lévodopa et l’apomorphine (un agoniste dopaminergique), sont disponibles sous forme de pompe, ce qui permet une administration plus finement dosée. Pour Marie Fuzzati, directrice scientifique de l’association France Parkinson, « ces traitements symptomatiques fonctionnent plutôt bien, même si les dosages doivent être adaptés au fil du temps et si leur efficacité est très variable d’une personne à l’autre. Mais aucun d’entre eux ne permet d’arrêter ou de ralentir la progression de la maladie ».
L’α-synucléine dans le viseur
« Pour la recherche, l’enjeu majeur consiste à découvrir un moyen d’empêcher les neurones de mourir », explique le Pr Olivier Rascol, responsable du centre expert Parkinson du centre hospitalier universitaire de Toulouse (Haute-Garonne) et coordinateur du réseau français de recherche NS-PARK*. « Dans les maladies neurodégénératives, on pense que les neurones recyclent mal certaines protéines, qui s’accumulent et forment des fibrilles toxiques qui les tuent. Pour la maladie de Parkinson, la protéine impliquée est l’α-synucléine, dont le rôle physiologique n’est pas très bien connu, mais qui serait impliquée dans la transmission synaptique. »
La maladie d’Alzheimer, également neurodégénérative, dispose déjà de premiers traitements qui agissent sur sa progression. Parmi eux, le lecanemab (Leqembi), un anticorps monoclonal ciblant les dépôts amyloïdes, devrait être bientôt disponible en France sous le régime d’accès précoce. Tel n’est pas encore le cas dans la maladie de Parkinson où le candidat le plus avancé, le prasinezumab, anticorps monoclonal dirigé contre l’α-synucléine, n’a pour l’instant obtenu que des résultats en demi-teinte sur les symptômes moteurs lors des essais de phase 2 Pasadena et Padova.
Selon Olivier Rascol, « les conclusions de ces deux études sont négatives sur le plan formel, mais certains résultats secondaires laissent penser qu’il existe un effet, peut-être plus modeste que celui espéré initialement, mais pas nul. Ce qui suggère qu’il est pertinent de continuer à explorer ce mécanisme ». Entre autres écueils, le fait que les anticorps franchissent difficilement la barrière hématoencéphalique ou qu’ils n’agissent que sur des cibles extracellulaires. Or l’α-synucléine est intracellulaire.
« Ils ne peuvent s’attaquer qu’aux formes toxiques d’α-synucléine passant d’une cellule à l’autre, et permettent donc d’éviter que la maladie se propage à d’autres neurones », explique le neuropharmacologue. Au-delà des anticorps monoclonaux, plusieurs types de médicaments conçus pour agir sur l’α-synucléine et plus à même de pénétrer dans le neurone sont en cours de développement, dont des peptides et de petites molécules. Parmi ces dernières, la minzasolmine a obtenu, en décembre 2024, des résultats négatifs de phase 2, ce qui a conduit à l’arrêt de son développement dans la maladie de Parkinson.
Outre l’α-synucléine, d’autres pistes sont à l’étude. « Les neurones des patients parkinsoniens présentent diverses anomalies moléculaires, par exemple, des troubles du fonctionnement de la mitochondrie, du lysosome, ou encore souffrent d’une activation de la microglie et de phénomènes de neuro-inflammation. La recherche se poursuit afin de trouver des médicaments qui ciblent ces divers mécanismes », explique Olivier Rascol. Là aussi, sans grand succès à ce jour : en 2022, la défériprone, un chélateur du fer (métal qui s’accumule dans le cerveau des parkinsoniens et serait associé à un stress oxydant), s’est avéré inefficace, une dégradation de l’état des patients a même été constatée.
Le score à l’épreuve
Davantage porteuse d’espoir, l’équipe d’Olivier Rascol a publié en avril 2024 les résultats positifs d’une étude de phase 2, LixiPark, évaluant chez 156 patients au stade précoce de la maladie la prise de lixisénatide, un agoniste du récepteur du GLP1 (arGLP1) indiqué contre le diabète de type 2. Plusieurs études observationnelles ont en effet suggéré que les personnes diabétiques traitées par arGLP1 présentaient un moindre risque de maladie de Parkinson.
Après un an, les patients du groupe traité affichaient une stabilisation du score mesurant leurs symptômes moteurs (MDS-UPDRS, sur une échelle de 0 à 132), alors qu’il avait progressé de trois points dans le groupe placebo. « Dans l’absolu, il s’agit d’un effet modeste, mais il était impossible d’observer une différence plus importante à un an, du fait de l’évolution lente de la maladie. En bloquant la progression dans le groupe “lixisénatide”, l’écart correspond à l’histoire naturelle de la maladie dans le groupe placebo. Et il ne s’agissait que d’une étude de phase 2, cherchant à établir un possible signal », explique Olivier Rascol.
Toutefois, d’autres résultats, publiés en février par une équipe britannique, sont venus jeter le trouble. Également menée sur des patients au stade précoce de la maladie, cette étude n’a pas démontré l’efficacité de l’exénatide, médicament proche du lixisénatide. « Pour l’instant, il nous est impossible de conclure : nos résultats sont encourageants, mais l’étude britannique ne les a pas reproduits », commente Olivier Rascol, dont l’équipe espère mener une étude de phase 3 sur le lixisénatide.
« Nous sommes toujours très prudents face au repositionnement de médicaments, indique Marie Fuzzati. Beaucoup de malades viennent nous voir à ce sujet, et nous leur répondons systématiquement qu’il faut attendre les résultats des études, que l’hypothèse reste à démontrer. De plus, aucun médicament n’est anodin, même s’il est déjà sur le marché. »
De la médecine de précision
Piste prometteuse supplémentaire, celle de traitements ciblés en fonction des caractéristiques génétiques du patient, à la suite de la découverte de plusieurs variants de gènes associés à un risque accru de l’affection. Parmi eux, le gène GBA1 code pour une glucocérébrosidase, dont l’activité semble réduite chez environ 10 % des patients. Ou encore le gène LRRK2, qui exprime une enzyme de type kinase, quant à elle suractivée chez 5 % des patients – voire jusqu’à 25 % chez ceux d’origine nord-africaine.
Pour chacune de ces deux cibles, des molécules destinées à corriger l’activité enzymatique sont en cours d’évaluation. « C’est de la médecine de précision : ces médicaments à l’étude ciblent des sous-groupes de patients porteurs de mutations dans un gène. C’est un peu comme dans la prise en charge du cancer : on ne traite pas forcément deux cancers du sein de la même façon », explique Olivier Rascol.
Autre front de recherche, la quête de biomarqueurs de progression, par imagerie, dans le liquide céphalorachidien ou dans le sang. « À ce jour, les traitements ne sont évalués qu’en fonction de l’évolution des symptômes moteurs. Or, au cours des premières années de la maladie, ils peuvent très bien ne pas trop s’aggraver. Ce n’est donc pas un bon marqueur, ce qui explique pourquoi les études coûtent cher, en raison de la nécessité de suivre les patients pendant plusieurs années », explique Marie Fuzzati. D’où la nécessité de disposer de biomarqueurs plus sensibles, afin d’estimer plus rapidement la réponse à une spécialité.
Au-delà du médicament, les recherches se poursuivent pour améliorer la stimulation cérébrale profonde (SCP, qui repose sur des électrodes implantées dans les noyaux subthalamiques), notamment par le recours à l’intelligence artificielle. D’autre part, la thérapie cellulaire, également à l’étude, vise à réapprovisionner le cerveau en cellules dopaminergiques.
S’il est un outil unanimement reconnu pour son efficacité, c’est l’hygiène de vie, à savoir « l’activité physique, la nutrition et un bon sommeil, rappelle Marie Fuzzati. De nombreuses études montrent que la progression de la maladie peut être nettement ralentie lorsque ces trois éléments sont réunis. Nous le voyons au sein de l’association : les personnes qui ont une activité physique régulière présentent une moindre progression de leurs symptômes. Et, plus largement, une meilleure qualité de vie ».
* Réseau national de recherche clinique sur la maladie de parkinson. NS-PARK appartient lui-même à la French Clinical Research Infrastructure Network (F-CRIN), créée en 2012 par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).
À retenir
- Contre la maladie de Parkinson, la médecine dispose de plusieurs traitements symptomatiques pour corriger la perte de production de la dopamine, liée à la destruction des neurones dopaminergiques.
- La recherche se poursuit afin de parvenir à des traitements qui permettent de freiner la progression de la maladie, notamment en empêchant l’agrégation de la protéine α-synucléine.
- En 2024, les résultats d’une étude française ont suggéré l’efficacité du lixisénatide, un agoniste du récepteur du GLP1 indiqué contre le diabète de type 2.
- Comptoir officinal : optimiser l’espace sans sacrifier la relation patient
- Reishi, shiitaké, maitaké : la poussée des champignons médicinaux
- Budget de la sécu 2026 : quelles mesures concernent les pharmaciens ?
- Cancers féminins : des voies de traitements prometteuses
- Vitamine A Blache 15 000 UI/g : un remplaçant pour Vitamine A Dulcis




