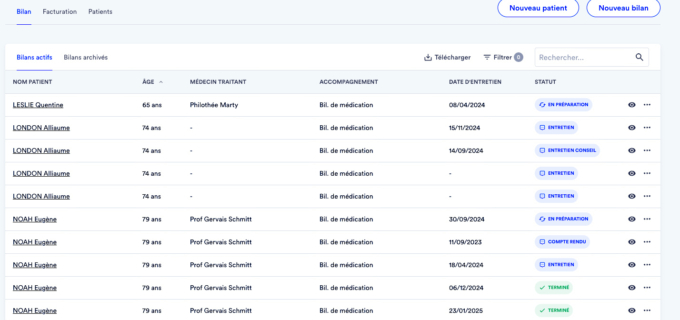- Accueil ›
- Profession ›
- Socioprofessionnel ›
- « LE DÉREMBOURSEME NT D’UN MEDICAMENT NE CONSTITUE PAS UN CONSTAT D’ECHEC »
« LE DÉREMBOURSEME NT D’UN MEDICAMENT NE CONSTITUE PAS UN CONSTAT D’ECHEC »
L’homme qui représente près de 600 mutuelles fait partager sa vision sans complaisance du système de santé et du rôle que doivent jouer les mutuelles.
Le Moniteur : Xavier Bertrand dénonce la forte consommation de médicaments par les Français. Est-ce aussi votre avis ?
Etienne Caniard : Nous sommes de gros consommateurs de médicaments, nos médecins sont de très gros prescripteurs, mais, paradoxalement, ces habitudes de consommation excessive cohabitent avec un sentiment de suspicion envers le médicament. Cette suspicion peut pourtant être particulièrement dangereuse en matière de santé publique. Il faut revoir notre rapport au médicament, être plus sélectif, sans oublier que les plus importants progrès médicaux de ces dernières années viennent des médicaments. Il y a toujours eu une méfiance des Français à l’égard de l’industrie pharmaceutique, mais pas à l’égard des produits. Aujourd’hui, le pas a été franchi et la méfiance s’est installée. C’est le moment pour réviser la politique du médicament, mais aussi la représentation du médicament dans la thérapeutique pour lui redonner toute sa place et uniquement sa place. Le récent rapport de la Haute Autorité de santé (HAS) sur le développement de thérapeutiques non médicamenteuses validées apporte un éclairage sur les marges de manœuvre existant dans ce domaine.
Le ministre veut reprendre en main la politique du médicament, alors que l’objectif de la création de l’Afssaps (à l’époque Agence du médicament) était d’avoir une agence indépendante du politique. Qu’en pensez-vous ?
Je me méfie des mouvements de balancier trop violents. Je pense qu’il est important que ceux qui ont en charge un secteur assument totalement leurs responsabilités. Le danger vient des confusions de responsabilités. Il faut effectivement préciser la place du politique. Aujourd’hui, cette place existe, puisque l’Afssaps et la HAS donnent des avis qui sont transformés en décisions par le politique. Je ne suis pas sûr, en revanche, que cette transformation en décisions se fasse avec toute l’expertise, tout le recul et toute l’analyse souhaitables. Si c’est ce qu’a voulu dire Xavier Bertrand, il a raison. Il faut effectivement que les politiques assument leurs responsabilités, mais se donnent aussi les moyens de les assumer. Une décision doit s’appuyer sur un processus qui fasse en sorte que la décision prise soit la meilleure possible.
Le ministre a déclaré que les études pour les AMM des médicaments seraient réalisées avec des comparateurs actifs s’ils existent. Ce qui conditionnera également leur remboursement. La Mutualité est-elle favorable à ces mesures ?
Pour nous, c’est indispensable. Nous avons une pharmacopée très importante en France, qui n’est pas sans influence sur les volumes de prescriptions. Lorsqu’un nouveau produit arrive sur le marché sans apporter de progrès thérapeutique, le prix fixé est en principe inférieur à ceux des produits équivalents présents sur le marché. Cela permet une économie qui reste très théorique. Lorsque dix ou quinze produits d’une même classe thérapeutique cohabitent sur le marché, les efforts de promotion des industriels conduisent à augmenter les volumes dans des proportions considérables sans pertinence thérapeutique. Cette augmentation de volumes crée évidemment des coûts, même si le prix du produit additionnel est plus faible. Et, plus important encore, la sécurité des patients est fragilisée à cause de la complexité de cette pharmacopée, des interactions, contre-indications, ou confusions éventuelles de médicaments. C’est d’ailleurs ce qui nous amène à préconiser la prescription en dénomination commune internationale chaque fois que cela est possible.
Les Assises du médicament et la réforme annoncée par le ministre n’ont pas abordé les prix des médicaments. Quelle est votre position sur ce sujet ?
Le Comité économique des produits de santé (CEPS) n’a pas participé aux Assises du médicament, ou peu. C’est dommage, car l’AMM est une décision sanitaire, mais personne n’ignore que c’est aussi une décision aux conséquences économiques importantes. Il faut bien sûr protéger et développer l’innovation. Mais s’il faut incontestablement y être attentif, il faut aussi être sélectif. La dépense en médicaments d’un pays n’est pas corrélée avec les résultats en matière d’innovation. Les rares produits innovants ne doivent pas devenir l’arbre qui cache la forêt des médicaments inutiles. C’est de cette façon que se créent des situations de rentes. Quand on est dans une situation de rente, on n’a aucune incitation, aucun intérêt à investir pour innover. C’est malheureusement le cas de la France. Nous tenons de grands discours sur l’innovation et nous entretenons des comportements de rentiers, qui freinent l’innovation et qui pénalisent finalement les laboratoires qui veulent faire un véritable effort dans ce domaine.
Concernant les problèmes de prix, le principal enjeu est de rendre compréhensible la fixation des prix. L’évaluation des médicaments se fait produit par produit, au niveau de l’AMM, du service médical rendu (SMR) et de son amélioration (ASMR). Tous ces éléments fournissent des informations afin de fixer le prix. Dans le même temps, à la fin de la procédure, le CEPS signe une convention laboratoire par laboratoire. En résumé, nous passons d’une entrée sanitaire basée sur les caractéristiques du produit à une sortie industrielle qui s’appuie sur les perspectives économiques et industrielles du laboratoire. Cela ne veut pas dire que la politique industrielle ne doit pas être prise en compte, mais que les décisions d’ordre sanitaire doivent relever des critères d’ordre sanitaire et que les décisions d’ordre industriel doivent être prises en s’appuyant sur des critères industriels. Il ne faut pas confondre les deux, ne pas instrumentaliser l’évaluation scientifique à des fins de politique industrielle ou économique, ce qui est la tendance en France.
Dans ce contexte, que pensez-vous du système de remises ?
Le système des remises est extrêmement pervers. C’est un système qui, dès l’origine de la fixation du prix, reconnaît « qu’il peut y avoir » des biais, notamment sur la population ciblée et le résultat des ventes des médicaments sous la pression de la promotion. Pour corriger cela, on considère donc que le laboratoire doit verser une remise à la collectivité pour tenir compte de ces changements. Ces remises sont versées au régime obligatoire. Cela veut dire que la remise diminue le prix effectif du médicament pour le régime obligatoire, et majore le taux de remboursement des complémentaires. C’est un transfert de charges qui ne veut pas dire son nom, cela pose un problème. Cela signifie aussi que le prix réel du médicament n’est plus le prix facial, puisque les remises font baisser ce prix. Lorsqu’on essaie de sensibiliser les médecins aux aspects médico-économiques, au prix de leurs prescriptions, on voit bien que ces éléments ne concourent pas à la transparence et à la compréhension du système. La situation est identique à l’hôpital. Si les prix y sont parfois très faibles, c’est pour amorcer une primo-prescription sans aucun rapport avec le coût ultérieur pour la collectivité quand il y aura une prescription en ville. Les prix sont fixés dans des conditions peu satisfaisantes, peu transparentes, peu lisibles. Il faut simplifier et mieux expliciter les décisions en matière de fixation des prix.
Pensez-vous qu’une partie des remises devrait être reversée aux complémentaires ?
Si les remises devaient subsister, la moindre des choses serait d’en faire bénéficier l’ensemble des financeurs. Ce n’est pas notre demande fondamentale. Notre demande fondamentale, c’est l’abandon du système de remises, peu satisfaisant, pour aller vers un système de fixation des prix plus rigoureux. Mais il faut aussi plus de rigueur sur la fixation des indications, les révisions des indications des médicaments, notamment pour limiter la prescription hors AMM. Quand on anticipe des prescriptions plus importantes que celles qui résultent des études, que l’on compense cette augmentation des volumes par des remises, on banalise la prescription hors AMM. Or, il est intéressant de noter qu’en cas de prescription hors AMM, la seule obligation qui incombe au médecin, c’est de marquer en marge de l’ordonnance « non remboursable ». Les pouvoirs publics ont le souci d’équilibrer les comptes de l’Assurance maladie, mais moins celui de la sécurité des Français. Nous sommes là dans un paradoxe tout à fait révélateur de la façon dont nous abordons les médicaments. Les aspects économiques à court terme, visibles, sont privilégiés et la notion de sécurité est trop négligée.
La Mutualité française s’est opposée au remboursement des médicaments à 15 %. Vos adhérents n’ont pas tous appliqué cette consigne. Quel bilan en tirez-vous ?
Le souhait de la Mutualité française n’a pas été suivi de façon absolue. Deux raisons expliquent cette situation. La première est la concurrence entre mutuelles, et entre complémentaires. Il s’agit d’une question fondamentale. S’il n’y a pas de régulation, la concurrence entre les organismes est délétère pour le système, car cette concurrence conduit à prendre en charge des dépenses qui ne sont pas forcément pertinentes. Or, toutes les sommes consacrées à ce type de prise en charge font défaut pour répondre à d’autres demandes. Deuxième raison : la catégorie des médicaments remboursés à 15 % est hétérogène. Il y a aujourd’hui, en juillet 2011, 664 produits qui sont remboursés à 15 %, dont 536 à SMR faible et 128 à SMR insuffisant. Il peut être logique pour un financeur de ne pas traiter sur le même plan ces deux catégories de produits. On peut très bien ne pas rembourser les médicaments à SMR insuffisant et considérer qu’il faut rembourser certains médicaments à SMR faible, en tout cas ceux pour lesquels il n’existe pas d’options thérapeutiques plus performantes. Or, les complémentaires n’ont pas accès à cette information. Ceci est un argument tout à fait recevable avancé par les mutuelles qui disent : « On ne peut pas priver nos adhérents de médicaments qui ont un SMR faible, en renonçant aux remboursements de l’ensemble des médicaments à 15 %. » Ce que je disais pour les prix trouve aussi à s’appliquer dans le domaine du remboursement : il faut simplifier ! Simplifier pour pouvoir expliquer clairement les choix de santé que nous faisons avec Priorité Santé Mutualiste.
Il y a également d’autres sujets d’étonnement. L’objectif de l’évaluation du SMR est la fixation du taux de remboursement. Or, il existe cinq taux de SMR et quatre taux de remboursement. Inévitablement, cette absence de concordance entre niveaux de SMR et niveaux de remboursement pose un problème de cohérence. Là encore, il faut simplifier. Nous pourrions avoir deux, trois taux maximum. Cela aurait l’énorme avantage de créer une situation plus lisible pour les patients et pour les prescripteurs. Le déremboursement d’un médicament ne constitue pas un constat d’échec. C’est le constat d’un progrès médical, de la disponibilité de produits plus efficaces, qui donnent de meilleurs résultats et qui conduisent à l’obsolescence des produits anciens. La réduction du nombre de taux aiderait à comprendre cela, et permettrait de faire davantage de pédagogie sur le remboursement. Cela aiderait peut-être aussi les médecins à recevoir l’information venant des laboratoires pharmaceutiques avec davantage de recul et d’esprit critique.
Les expérimentations Babusiaux permettent aux mutuelles d’avoir des données sur les médicaments remboursés. Quels sont les résultats de ces expérimentations ?
Un certain nombre d’expérimentations se sont déroulées entre 2007 et 2009 et ont donné des résultats satisfaisants. Il faut rappeler leurs objectifs. Le premier consistait à distinguer le SMR à l’intérieur d’un même taux de remboursement. Le deuxième avait pour finalité de tester le remboursement de produits princeps au prix moyen du générique. Le troisième était d’essayer de répondre aux stratégies de contournement avec les « me too », rembourser par exemple l’ésoméprazole au prix de l’oméprazole. Enfin, il s’agissait de créer des groupes de génériques virtuels du paracétamol et de l’acide acétylsalicylique. Ces expérimentations devaient nous permettre de tester leur efficacité technique et de mesurer l’impact économique des mesures. Elles ont montré que nous pouvions dégager des marges de manœuvre économique de 6,2 % sur les dépenses en appliquant ces règles. Ces marges pourraient être utilisées par exemple pour améliorer la prise en charge de certains dispositifs médicaux ou pour financer des actions d’éducation thérapeutique. Aujourd’hui, nous travaillons à l’extension de ces expérimentations à l’ensemble du territoire et des pharmaciens.
Mais rembourser les princeps sur les prix de leurs génériques implique pour les patients un reste à charge plus important ?
Les décisions des mutuelles ont une influence sur la structure des dépenses. Le déremboursement des médicaments à 15 % a conduit ainsi à une diminution considérable de la vente de ces produits. Nous ne voulons pas dire aux patients : « Nous vous faisons porter une charge supplémentaire », mais : « Il y a pour vous la possibilité d’acquérir un produit qui a la même efficacité à un prix plus faible. Donc nous vous incitons à le faire. » C’est ça l’économie. Nous voulons changer des habitudes de consommation par des changements de règles. C’est un sujet compliqué, qui demande une collaboration de tous les acteurs, y compris les pharmaciens. Si nous voulons que cela marche, il ne faut pas que leur rémunération soit altérée par ces changements de pratique. C’est un ajustement précis, complexe à mettre en œuvre.
Les mutuelles peuvent-elles jouer un rôle pour financer les nouvelles missions des pharmaciens créées par la loi HPST ?
Est-ce qu’il y a un terrain de contractualisation et de travail commun avec les pharmaciens autour de ces nouvelles missions ? La réponse est oui. Et cela sans aucune réserve. La raison est très simple : les missions qui sont potentiellement confiées par la loi HPST aux pharmaciens – soins de 1er recours, éducation thérapeutique, actions d’accompagnement des patients, conseil – sont des sujets de coopération interprofessionnelle. Sujet sur lequel on ne travaille pas assez en France, car on reste enfermé dans un certain corporatisme. Or, le pharmacien est évidemment l’un des professionnels de santé de proximité les plus importants. Il y a beaucoup d’actions à entreprendre notamment autour des pathologies chroniques, autour du renouvellement des prescriptions. L’officine ne peut pas rester dans une logique de produits. Il faut qu’elle change de paradigme et s’intègre à une économie de services à valeur ajoutée. Et nous voulons valoriser cette économie de services à laquelle nous souhaitons participer. Mais il faut avoir conscience des difficultés. Nous devons décrire ces services, disposer de critères de qualité, déterminer les modalités de financement. Faut-il mettre en œuvre des protocoles ou codifier ? Faut-il une rémunération forfaitaire, par capitation ou bien à l’acte ? Nous n’avons pas forcément les réponses. Nous avons commencé à travailler avec les représentants de la profession des pharmaciens sur ce sujet pour regarder de quelle façon nous pouvons avancer. Pour nous, il est clair que c’est une priorité importante. Maintenant il faut travailler concrètement. En quoi les nouvelles missions des pharmaciens peuvent faire faire des économies à la collectivité ou en quoi peuvent-elles apporter une valeur ajoutée en termes de qualité, qui justifie un financement ? Il ne s’agit pas d’être dans une logique d’amélioration des revenus pour les pharmaciens sans se poser la question du contenu du service qui va être fourni aux assurés sociaux.
Cela signifie que ces nouveaux services seront rémunérés au détriment d’autres actes ?
Notre système de santé sait ajouter, mais il sait moins bien substituer. Si nous continuons sur la voie sur laquelle nous nous sommes installés avec une certaine inconscience et un faux confort depuis quelques années, nous risquons de nous retrouver avec un système en faillite et des décisions dramatiques pour l’accès aux soins des Français. Nous le voyons aujourd’hui dans quelques domaines tels les dépassements d’honoraires. L’incapacité de l’Assurance maladie de rémunérer correctement certains actes, tout en surpayant d’autres, conduit à des pratiques qui sont devenues aujourd’hui complètement banalisées, complètement généralisées, et qui changent pourtant la nature même du système. Prenons un exemple : le dépassement moyen des honoraires des oto-rhino-laryngologistes en secteur 2 est de 60 %. Concrètement, le remboursement pour l’assuré social en secteur 2 n’est plus de 65 % mais d’environ 40 %. Nous n’avons pas conscience de la gravité des déséquilibres de notre système, des choix qu’il va falloir faire. Il y a incontestablement des marges de manœuvre, mais si, à chaque fois, nous ne raisonnons que sur les dépenses supplémentaires sans essayer de rationaliser notre offre, nous courons à la catastrophe. La faillite de la Sécurité sociale serait un désastre pour les assurés sociaux, et ce ne serait pas non plus une perspective bien réjouissante pour les professionnels de santé. Je crois que nous devons tous être vigilants. Et la question du rôle des pharmaciens se pose évidemment dans ce contexte général.
Les réseaux de santé mis en place par les mutuelles peuvent-il englober les pharmaciens ? Et peuvent-ils peser sur des changements d’habitudes des patients ?
C’est l’objectif. A un moment où tout le monde s’accorde à reconnaître le caractère indispensable des complémentaires dans l’accès aux soins, où les pouvoirs publics font de plus en plus appel aux complémentaires sous différentes formes, où elles jouent un rôle de plus en plus important dans le financement, peut-on imaginer de les exclure des mécanismes de régulation ? Ce serait paradoxal. Raisonnons par l’absurde. Très souvent, on a tendance à dire qu’une bonne mutuelle, c’est une mutuelle qui rembourse bien. Il faut aller plus loin. Une bonne mutuelle, c’est une mutuelle qui rembourse bien des soins pertinents. Pour ces raisons, la Mutualité veut pouvoir contracter totalement et librement avec des professionnels. Pourquoi cette liberté de contractualiser effraierait-elle les professionnels libéraux ? Personne ne peut obliger un professionnel à contractualiser avec un financeur. Les risques sont partagés par les deux parties et nous pouvons penser qu’aujourd’hui, avec la démographie médicale, les professionnels sont plutôt dans un rapport de force qui leur est favorable.
Quel serait le système de santé idéal ?
Dans l’immédiat, un projet de loi relatif à la modernisation des produits de santé nous est présenté. Naturellement, la Mutualité française accueille favorablement tout projet qui affiche l’ambition de moderniser le système des produits de santé. Toutefois, ce projet est une réponse très partielle aux réformes attendues dans ce domaine. Il se positionne très en deçà des attentes des usagers et des dernières déclarations ministérielles. Il est regrettable que le travail réalisé au cours des Assises du médicament, ainsi que les préconisations des différents rapports réalisés au cours du printemps, n’aient pas trouvé prolongement et concrétisation dans ce projet de loi. Ce texte ne saurait donc rester en l’état.
Pour répondre directement à votre question, un système de santé idéal serait un système dans lequel il y aurait un choix explicite sur les actes de santé pertinents pris en charge par la collectivité et les complémentaires. Et une lisibilité du système qui permette un minimum d’opposabilité pour que les assurés sociaux sachent ce qu’ils vont avoir et à quel prix. Cela nécessite des mécanismes complexes afin de trouver le juste équilibre, alors que les complémentaires financent une partie importante des soins. N’oublions pas qu’en matière de soins de ville, l’Assurance maladie rembourse à peine plus de 50 % des dépenses. Le rôle des compémentaires est donc majeur. Dans le secteur 2, les complémentaires deviennent le premier financeur, avant l’Assurance maladie. Tout le monde oublie cette réalité. Il est plus que normal qu’il y ait un dialogue, une contractualisation entre les complémentaires et les professionnels de santé.
Etienne Caniard, en 8 dates
1990 Président de la Mutuelle des agents des impôts
1992-1996 Trésorier puis vice-président de la Mutualité fonction publique
1994 Administrateur de la Mutualité française
1991-1998 Membre de la Haute Autorité de santé (HAS)
1996-2004 Préside la commission santé-prévention de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
2001 Vice-président de l’Observatoire national d’éthique clinique
2004 Membre du collège de la HAS, chargé de la qualité et de la diffusion de l’information médicale
14 décembre 2010 Président de la Mutualité française
- Rémunération des pharmaciens : une réforme majeure se prépare-t-elle ?
- Les métiers de l’officine enfin reconnus à risques ergonomiques
- Remises génériques : l’arrêté rectificatif en passe d’être publié
- Réforme de la rémunération officinale : quelles sont les propositions sur la table ?
- Paracétamol : quel est cet appel d’offres qui entraînera des baisses de prix ?
- Comptoir officinal : optimiser l’espace sans sacrifier la relation patient
- Reishi, shiitaké, maitaké : la poussée des champignons médicinaux
- Budget de la sécu 2026 : quelles mesures concernent les pharmaciens ?
- Cancers féminins : des voies de traitements prometteuses
- Vitamine A Blache 15 000 UI/g : un remplaçant pour Vitamine A Dulcis