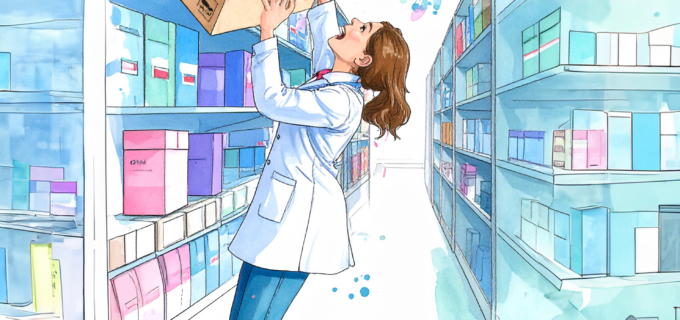- Accueil ›
- Législation ›
- Droit du travail ›
- Temps de travail et congés ›
- Embaucher un étudiant : les règles à respecter

© Shutterstock
Embaucher un étudiant : les règles à respecter
Travailler en officine représente, pour les étudiants en pharmacie, une réelle opportunité d’allier complément de revenus et expérience formative. Côté employeur, renforcer l’équipe à des horaires stratégiques offre une flexibilité salutaire. Toutefois, cette convergence d’intérêts ne doit pas masquer l’obligation de respecter un ensemble de règles parfois méconnues.
Nul n’est censé ignorer la convention collective ! Si le contrat de travail du futur pharmacien mentionne généralement le statut d’étudiant dans le cadre de ses missions, il ne saurait écarter la mise en œuvre des dispositions applicables à tout salarié de l’officine. Ainsi, le respect de la convention collective impose un contrat écrit, mentionnant notamment la date de début d’exécution de celui-ci, la catégorie professionnelle dont relève le salarié, l’emploi, le coefficient hiérarchique, mais aussi le salaire et les autres éléments éventuels de rémunération. Il doit aussi faire figurer la durée de la période d’essai s’il y a lieu, celle du travail, la répartition hebdomadaire ainsi que le lieu de travail, les organismes de prévoyance et de mutuelle santé… À cette liste, il convient d’ajouter, conformément à la loi, la nécessité d’avoir recours à un écrit lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée (CDD), mais aussi en matière de temps partiel.
Une flexibilité limitée
Selon l’article L. 4241-10 du Code de la santé publique, les étudiants étant autorisés à travailler en officine « dans un but de perfectionnement » et « en dehors des heures de travaux universitaires », le recours au temps partiel semble être le plus indiqué et impose de prévoir la durée hebdomadaire ou mensuelle. Ainsi, la convention collective rappelle que s’ils ont moins de 26 ans, ils peuvent prétendre, de droit, à une durée de travail inférieure à la durée minimale de 16 heures par semaine et « compatible avec leurs études ». Par ailleurs, l’employeur est déchargé de l’obligation de demander une dérogation individuelle écrite et motivée, ainsi que de celle de regrouper les horaires sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Des obligations qui lui incombent pour tous les autres salariés.
Toutefois, l’absence de durée, ou le recours à une formulation vague de type « selon les besoins de l’officine », induit un risque pour l’employeur. Ainsi, en l’absence de preuve d’une stabilité des horaires, la cour d’appel de Lyon (Rhône) a pu requalifier rétroactivement la durée à temps complet, condamnant l’employeur à une lourde indemnité, dans un arrêt du 12 juin 2020 (voir encadré).
Seule solution : prévoir une durée limitée et l’augmenter selon les besoins, avec l’accord préalable de l’étudiant. La technique de l’avenant « complément d’heures » est prévue par la convention collective, ce qui permet de réaliser jusqu’à cinq avenants par an, de huit semaines consécutives au maximum. Attention, toutefois, à appliquer la majoration de 15 % des heures effectuées au-delà de la durée initiale. Il est bien entendu déconseillé de contourner ce cadre en recourant à des contrats successifs. L’étudiant a en effet la possibilité de refuser de faire marche arrière, et l’employeur s’expose à un contentieux devant le conseil de prud’hommes menant à une issue défavorable.
À retenir
- Établir un contrat de travail écrit.
- Recueillir l’accord préalable de l’étudiant en cas de changements d’horaires ou de durée de travail.
- Veiller à utiliser les avenants compléments d’heures en appliquant le taux de majoration.
- Toujours rompre formellement le contrat.
La fin de contrat
Même si le statut d’étudiant est par nature temporaire, le recours au CDD ne peut être envisagé que dans les cas prévus par la loi (remplacement, accroissement temporaire d’activité ou activités saisonnières), au risque de subir une requalification en contrat à durée indéterminée (CDI). Par ailleurs, la fin des études peut parfois poser des difficultés car elle impose une rupture du contrat de travail formelle, soit par une démission, une rupture conventionnelle ou un licenciement. À défaut, le contrat perdure, la période de stage ne constituant pas un motif de rupture automatique. Cette poursuite du contrat avec un pharmacien diplômé impose alors de revoir à la hausse le coefficient et, si le salarié le souhaite, un retour à la durée minimale de 16 heures peut être demandé. Mieux vaut donc anticiper cette situation.
Par Thomas Morgenroth de l’Association des enseignants de droit et économie pharmaceutiques
L’exemple d’un contrat étudiant requalifié à temps complet
Que s’est-il passé ?
M. X est embauché en tant qu’aide en officine à temps partiel à compter du 4 septembre 2010. Il effectue son stage de fin d’études au sein de la même pharmacie, du 18 novembre 2013 au 17 mai 2014. À l’issue de son stage, il réclame une lettre de licenciement afin de mettre fin au contrat de travail. À la suite des différents refus de son ancien employeur, il signifie par courrier recommandé du 29 octobre 2013 sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Quelle discussion en a suivi ?
Deux principales questions ont été étudiées. D’une part, il apparaît que le stage n’entraîne pas automatiquement la rupture du contrat de travail, celui-ci étant simplement suspendu. À l’issue de cette période, quelle suite aurait donc dû être donnée au contrat ? Aurait-il dû se poursuivre ou être rompu ?
D’autre part, l’étudiant n’ayant pas de contrat de travail écrit, pouvait-il être reconnu comme travaillant à temps partiel ? En l’absence de preuve apportée par l’employeur sur la stabilité des horaires et du temps de travail, le contrat doit-il être considéré à temps complet ?
Comment les juges ont-ils tranché ?
Les juges ont estimé que dans la mesure où le contrat a perduré à la suite de la période de stage et puisqu’il n’y pas eu de rupture de contrat formalisée, la prise d’acte signifiée par l’étudiant était justifiée. Cette rupture a produit les effets d’un licenciement abusif et M. X n’a perçu aucune indemnité de fin de CDD, ni de licenciement. L’employeur a par ailleurs refusé de lui payer les majorations salariales de 3 % dues après trois ans d’ancienneté.
De plus, faute de preuve – ont été considérés comme insuffisants les relevés manuscrits d’heures, relevés de ventes au comptoir, l’emploi du temps universitaire, etc. –, le contrat a été requalifié à temps complet, de façon rétroactive. Au total, l’employeur se voit condamné à verser 86 430 € à M. X.
Source : cour d’appel de Lyon, 12 juin 2020, n° 18/00498.
- Comptoir officinal : optimiser l’espace sans sacrifier la relation patient
- Reishi, shiitaké, maitaké : la poussée des champignons médicinaux
- Budget de la sécu 2026 : quelles mesures concernent les pharmaciens ?
- Cancers féminins : des voies de traitements prometteuses
- Vitamine A Blache 15 000 UI/g : un remplaçant pour Vitamine A Dulcis

Salaires et nouvelle grille des coefficients : le compte à rebours a commencé